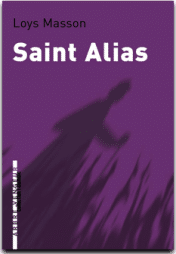
Saint Alias est une petite nouvelle, ce genre de nouvelle qui se lit presque d’une traite et se vit comme un voyage. Et c’est dans une jolie contrée qu’elle nous amène. Un pays, en un mot, fantastique. Saint Alias est un homme mystérieux qui s’installe dans un petit village. Il est bon, très bon, et prend vite à cœur de faire le bonheur de tous les habitants. Car Saint Alias n’est pas comme tout le monde, c’est un prestidigitateur. Il tient un registre d’âmes en peine qu’il console par magie. Très vite, il gagne l’affection et le respect des villageois, s’occupe de ce simplet que le pasteur a découragé d’épouser sa belle, de cette austère dévote qui ne veut pas mourir, non par crainte de la mort, mais des vers qui la mangeront, ou bien encore d’une jeune fille un peu excentrique qui veut se marier à tout prix. Tout cela se fait dans une atmosphère des plus étranges, comme un rêve charmant et inquiétant à la fois.
Le génie de Masson, à mon sens, est d’avoir su plier le langage à cette ambiance et déployer des métaphores décalant magiquement la langue des lieux communs pour la placer dans un univers féérique. On ressent en le lisant une impression d’habitude rassurante – les mots sont ceux qu’on utilise tous les jours – mais qu’on sent, grâce à leur surprenant assemblage, s’entremêler à une étrange nouveauté qui nous enchante. Ainsi Masson pour décrire les frissons de la nuit et son décalage avec le jour ne dit-il pas que le froid mord et que tout semble endormi, mais plutôt « l’air était paisible, avec de soudaines petites grimaces de froid. Chaque arbre était un aïeul appuyé sur une béquille de clair de lune ». Ou bien, lorsqu’il veut décrire le bonheur : « le soleil frappa trois coups de son bâton comme le régisseur au théâtre. L’écureuil salua. Le chêne dit « mea culpa » par deux fois puis éclata de rire. Et deux tiges d’herbe portèrent un toast ; elles burent ; le soleil remporta les verres vides. »
C’est donc un texte emprunt de poésie que nous livre Masson, qui nous embarque dans un lieu inédit où tout est possible, aussi bien dans les choses que dans la manière de les raconter, et ce dépaysement de l’étranger est bien agréable. C’est peut-être sa plus grande qualité qui a desservi Masson, un étrange qui dérangerait, déconforterait trop.
« S’étant laissé tomber dans un fauteuil, il bourra sa pipe et fit flamber une allumette. Son col pourtant l’incommodait encore : il passa la main sur son col plusieurs fois, comme pour tâcher de l’élargir, mais sans succès ; alors, très posément, il râpa une seconde allumette, l’approcha de l’ennuyeux celluloïd et y mit le feu. Le col brûla avec une flamme claire et une mince fumée qui, au lieu de monter comme il est d’usage chez les fumées, se plaqua au sol au contraire où elle forma peu à peu une boule moitié noire et moitié bleue. Lorsque le dernier brin de tabac de la pipe se fut consumé, l’homme siffla et de la boule moitié noire et moitié bleue sorti un chien (qui était tout noir avec des yeux bleus et vint se frotter au fauteuil). L’homme siffla sur un ton plus aigu, puis imita avec sa bouche le bruit du tonnerre, du chat amoureux, d’un train qui passe à toute vitesse dans la brume, et à mesure — pour ce qui était sans nul doute un jeu — l’animal s’excitait, aboyait à petits coups. Après l’avoir léchée, soudain il avala la main de son maître et la restitua — et poursuivit cet exercice une dizaine de fois, tant qu’il eut faim, présume-t-on. Lorsque le ventre du chien se fut suffisamment arrondi, M. Alias le plia soigneusement et l’enferma dans un coffret. Sur le coffret était écrit : Niche du chien Jessup, dans un parterre de fleurs rouges et jaunes.
[…] Le matin secoua les vitres : elles s’éveillèrent avec un bâillement. La misère alla remplir ses seaux à la fontaine. L’usurier, l’accoucheur en retraite, le pasteur, le marchand de bois encore chauds de sommeil, avalèrent à petites gorgées — chacun chez soi — un grand bol de lait. Le village teinta du métal des chants des coqs. La charrette de Kirby passa dans un grincement de ridelles ; quand la route devenait moins caillouteuse et que le gémissement faisait trêve, on entendait le vieil enfant Kirby jurer doucement. »